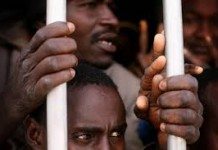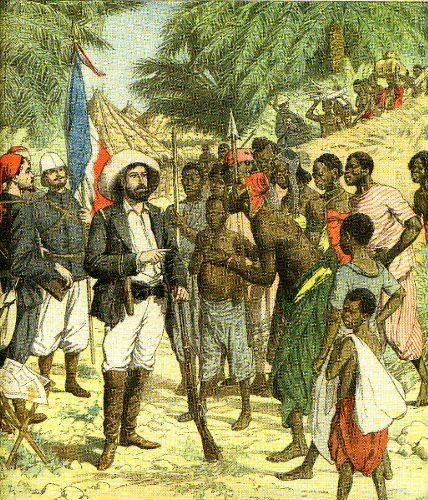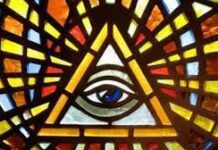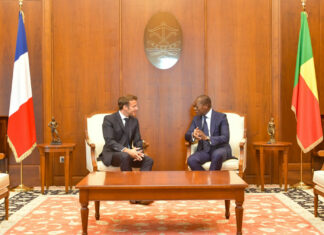Les États-Unis, jadis sûrs d’être le phare démocratique du monde, vivent désormais dans une contradiction profonde : proclamer la liberté tout en soutenant l’occupation, invoquer les droits de l’homme après avoir armé ceux qui les effacent, parler de paix tout en entretenant la guerre permanente. Aucun événement n’a révélé cette contradiction plus crûment que Gaza.
Depuis près de deux ans, les États-Unis déplorent une catastrophe humanitaire que leurs propres armes entretiennent. Ils appellent à la retenue tout en réapprovisionnant les arsenaux de la dévastation. Ils vantent un « ordre international fondé sur des règles » à propos de l’Ukraine, tout en défendant des exceptions — à Gaza et au Liban — qui rendent ces règles caduques. L’écart entre les idéaux américains et leur conduite n’est plus cosmétique, il est structurel.
L’Amérique ne cherche plus à résoudre ses contradictions, elle les justifie.
Deux ambitions incompatibles
Depuis 1945, les États-Unis ont fusionné deux ambitions incompatibles : agir en hégémon mondial et se présenter comme modèle moral. Leur exceptionnalisme promettait de transformer la puissance en vertu, l’intervention en délivrance. Cette illusion a tenu jusqu’à ce que la contradiction la submerge. Le Vietnam l’a brisée. L’Irak et l’Afghanistan l’ont enterrée. Gaza pourrait la rendre irréversible. Chaque guerre a exigé un récit pour concilier brutalité et bienveillance : « répandre la démocratie », « combattre le terrorisme », « défendre Israël ». Chacun fut un instrument psychologique permettant de préserver l’estime de soi tout en violant les valeurs proclamées — la nécessité de demeurer vertueux tout en se montrant impitoyable, de croire que la violence peut être humanitaire et que la pureté morale peut survivre au compromis moral.
Gaza a poussé cette logique jusqu’à l’effondrement. Les États-Unis affirment qu’Israël a le droit de se défendre, mais refusent aux Palestiniens celui de survivre. Ils condamnent la mort de civils tout en opposant leur veto aux résolutions de cessez-le-feu de l’ONU. Chaque famine, chaque hôpital bombardé exige une nouvelle justification : « éliminer le Hamas », « aucune démocratie ne peut tolérer le terrorisme à ses frontières ». Ce ne sont pas tant des mensonges que des auto-absolutions. Reconnaître les conséquences morales de Gaza reviendrait à affronter la dissonance entre l’image de l’Amérique comme arbitre de la justice et son rôle de complice de la mort de masse. La dissonance est devenue doctrine. Les États-Unis internalisent désormais l’impunité d’Israël, en faisant le prolongement de la leur.
Le ton de leur diplomatie depuis octobre 2023 traduit cette angoisse : chaque déclaration d’inquiétude s’accompagne d’un nouvel envoi d’armes, chaque appel à la retenue d’un nouveau veto. La nation qui jadis disciplinait les autres par le langage moral discipline désormais le langage lui-même pour éviter tout examen moral. Gaza révèle ainsi non seulement un échec géopolitique, mais un échec psychologique : l’incapacité à distinguer la conviction de la commodité.
Loin dans l’Histoire.
Au Vietnam, Washington appela « défense de la liberté » le bombardement massif. En Irak, il nomma « libération » l’invasion. En Afghanistan, il invoqua les droits des femmes tout en soutenant seigneurs de guerre et drones tueurs. Chaque échec fut requalifié : « erreur », « mauvaise évaluation », « tragédie ». Jamais les États-Unis n’affrontèrent la contradiction centrale : leur mission morale autorise une puissance sans limites. Gaza et le Liban en sont l’aboutissement, avec une différence : le monde regarde désormais en temps réel, armé de caméras et de conscience. L’empathie sélective de l’empire — qui mérite d’être pleuré, qui peut être expliqué — ne peut plus se cacher derrière la distance.
Et à l’intérieur du pays, une fracture générationnelle s’élargit. La jeunesse, chez les démocrates, les républicains et surtout les indépendants, transforme la crise morale de Gaza en affrontement entre jeunes et anciens, privilégiés et déclassés. Comme au temps du Vietnam, cette révolte naît non d’une participation directe, mais de l’exposition aux images. Le traumatisme des tueries et de la famine résonne comme si l’Amérique était de nouveau en guerre avec sa propre conscience.t
Mais ce mécanisme se fissure. Les sondages se succèdent et montrent un renversement générationnel : pour la première fois, davantage d’Américains — surtout les jeunes — se disent solidaires des Palestiniens que des Israéliens. Les responsables politiques ignorent cet avertissement, s’accrochant au langage d’un ordre moral révolu. Même certaines figures populistes de droite — Kirk, Carlson, Kelly, Bannon — reconnaissent ce basculement. La dissonance n’est plus externe : elle ronge désormais de l’intérieur.
L’ordre libéral construit après 1945 reposait sur un mythe : celui d’une puissance morale, d’une hégémonie compatible avec la justice. Gaza a brisé ce mythe. La défense obstinée par Washington de l’impunité israélienne a aliéné l’Europe, éloigné le Sud global et révélé la décadence du projet libéral. Quand 140 nations votent pour la reconnaissance de la Palestine et que les États-Unis opposent leur veto, la rupture n’est pas diplomatique, elle est existentielle.
L’empire continue de parler, mais son vocabulaire a perdu son sens.