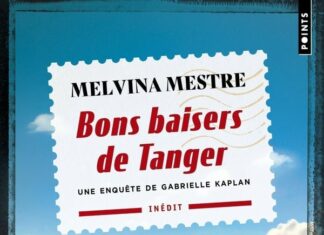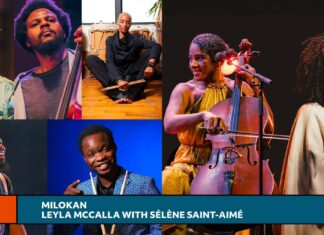Il est de ces hommes dont la voix ne s’éteint pas avec le temps. Elle résonne, s’infiltre dans les murs de la République, hante nos consciences lorsque la justice chancelle. Robert Badinter était de ceux-là , un homme de droit, un homme de parole, un homme de combat. Aujourd’hui, il entre au Panthéon. Et avec lui, c’est la liberté qui franchit à nouveau les portes de ce temple républicain.
Riadi Taha, Membre du Parlement Jeunesse du Maroc , Membre du Congrès National du PAMÉtudiant en Droit Science Politique à l’université de Bordeaux
« La liberté, c’est comme la santé, on est capable de la définir quand on ne l’a plus. »
Cette phrase, à la fois simple et vertigineuse, dit tout du rapport que Badinter entretenait avec le droit : la liberté n’est pas un slogan, c’est une responsabilité. Elle ne se célèbre pas, elle se défend. Elle ne s’impose pas, elle s’exerce, chaque jour, dans les tribunaux, dans les lois, dans les gestes quotidiens de l’État de droit.
On se souvient du garde des Sceaux de 1981, debout devant l’Assemblée nationale, affrontant les huées pour défendre ce qu’il appelait « l’honneur de la justice française » : l’abolition de la peine de mort.
Ce jour-là, Robert Badinter n’a pas seulement gagné une bataille politique, il a déplacé le centre moral de la République. Il a rappelé que le droit n’est pas une vengeance codifiée, mais une éthique en action, un espace où la raison et la compassion se rencontrent.
Son combat s’inscrivait dans la lignée de Montesquieu et de Beccaria : le pouvoir de punir doit toujours être limité par la raison et la dignité humaine. La justice ne peut être juste que si elle renonce à la cruauté.
Il avait compris que la société se juge à la manière dont elle traite ceux qu’elle rejette, pas à la force avec laquelle elle condamne.
L’entrée de Robert Badinter au Panthéon n’est pas un simple hommage ; c’est un acte politique au sens noble.
Le Panthéon, ce lieu où repose la mémoire des combats républicains, retrouve ici son souffle.
Entre Victor Hugo, Jean Moulin, Simone Veil et Voltaire, voici désormais l’homme qui a rendu à la justice sa part d’humanité.
Son entrée au Panthéon est un message adressé à notre époque troublée : ne jamais céder à la tentation de la peur, ni au confort du renoncement.
C’est rappeler que la liberté n’est jamais définitivement acquise, qu’elle se perd souvent par indifférence avant de disparaître sous la contrainte.
C’est une invitation à la vigilance, à la lucidité, à ce courage tranquille qu’il incarnait si bien.
Badinter voyait dans le droit non pas une mécanique, mais une morale.
Pour lui, être juriste, c’était être gardien de l’humain. Il disait souvent que « la peine de mort est l’échec absolu de la justice ».
Dans sa bouche, ce n’était pas un effet de rhétorique : c’était une conviction née de la douleur, de la mémoire de la Shoah, de l’expérience du procès, du regard porté sur les vaincus.
Dans un monde où l’on confond souvent justice et vengeance, sécurité et liberté, son héritage nous invite à penser autrement. Il nous rappelle que la grandeur d’un État ne se mesure pas à la sévérité de ses peines, mais à la justesse de ses principes.
Il nous enseigne que la loi, pour être respectée, doit d’abord être respectable.
Robert Badinter rejoint au Panthéon non pas seulement des morts illustres, mais aussi des vivants invisibles : ceux qui continuent de croire à la force du droit, à la noblesse du verbe, à la lente victoire de la raison sur la haine.
Son visage grave, sa voix calme, ses mots précis resteront comme une boussole dans un siècle où les certitudes vacillent.
Car il nous laisse une leçon simple : la liberté se mérite, et la dignité se protège.
Robert Badinter ne reposera pas seulement au Panthéon : il continuera d’y veiller.
Et peut-être qu’en levant les yeux vers la coupole, on entendra encore sa voix murmurer :
« La liberté, c’est comme la santé, on la comprend quand on ne l’a plus. »