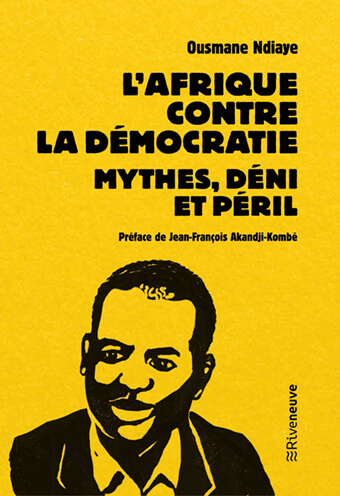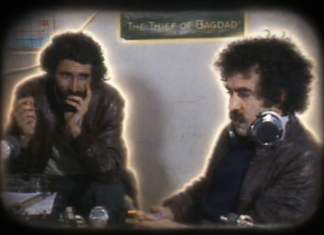Si l’on n’y prend garde l’ouvrage d’Ousmane Ndiaye pourrait apparaître comme un brûlot, il n’en est rien ! L’auteur, journaliste de formation, fait œuvre de pédagogie et de didactisme ce qui tranche avec les discours et les écrits de l’époque ; qui donnent dans le catastrophisme ou, c’est peut-être pire, la complaisance.
Kader A. Abderrahim
Ousmane Ndiaye, L’Afrique contre la démocratie, mythes, déni et péril, éditions Riveneuve, 172 pages, août 2025, Paris.
Voici un essai percutant sur une tendance actuelle sur le continent africain : le rejet de la démocratie libérale par les putschistes, les masses et les élites car non-adaptée aux « valeurs africaines ».
En rupture avec les idées reçues, l’ouvrage replace la crise démocratique en Afrique dans son contexte historique et rappelle les termes de l’universel. Un ouvrage érudit et très informé analysant plusieurs cas : Mali, Burkina Faso, Sénégal, Afrique du Sud, Rwanda… et décryptant l’aveuglement du nouveau panafricanisme assimilant démocratie et/à Occident.
Après avoir sillonné le continent, d’Est en Ouest, du Maghreb à l’Afrique australe pendant 20 ans Ousmane Ndiaye appuie sur pause et nous propose une réflexion sur la gouvernance, l’absence de débat, la citoyenneté ou la gestion de l’économie. On sera captivé par le kaléidoscope analytique proposé par l’auteur qui rassemble des figures politiques, des figures intellectuelles ou des économistes une diversité qui nous (re) met en lumière la complexité des situations et la responsabilité des élites africaines.
Démonter les mythes
Voici un travail de déconstruction que le présent essai s’attache à réaliser avec force arguments, exemples concrets que le lecteur appréciera car notre narrateur est fin connaisseur des sociétés africaines.
Le second étage de la fusée est le déni instrument de domination occidentale et dans le même mouvement de la tentative de mettre de côté la responsabilité des dirigeants africains et de leurs échecs. Ce qui ressemble à une dépossession, un refus d’accorder aux africains les droits et les pratiques qui pourraient conduire à l’émergence d’une citoyenneté éclairée afin de répandre la démocratie.
In fine s’inscrivant au diapason, sans l’adopter, du Continent Ousmane Ndiaye nous propose une voie ternaire pour compléter sa démarche, celle du péril, directement issue de l’histoire post indépendance « le péril ONG », qui aura, la main sur le cœur, tenter d’imposer la démocratie par le bas.
L’autre péril est « kaki » ou la fascination des putschs et de la gouvernance par des militaires. Le rejet du premier n’aura pas permis d’établir des États qui servent l’intérêt collectif, lorsque le second se complait à exacerber le néo souverainisme sans dessiner de projet global de sortie de crise.
L’Afrique rétive à la démocratie?
La barrière culturelle est souvent évoquée pour expliquer les difficultés rencontrées par l’Afrique dans son processus de démocratisation. La culture du chef qui caractérise les sociétés africaines ne serait pas un bon réceptacle pour enraciner la démocratie. En réalité, cette culture ne saurait être un frein à l’émergence de la démocratie ; cette idée reçue est erronée.
Les préjugés ont la peau dure : « si l’on ne voit la démocratie qu’à travers les trois révolutions américaine, britannique et française, on écrit une histoire incomplète »[1].
La plupart des nations africaines avant la colonisation étaient constituées en royaumes dont l’organisation n’était pas éloignée de celle de la monarchie parlementaire britannique.
Les affaires de la cité se réglaient autour « des arbres à palabres » avec la participation des populations ou leurs représentants : c’était le temps de légiférer, de décider, de juger.
A contrario l’héritage de la colonisation est la politique du diviser pour mieux régner et le repli ethnique.
Si « la démocratie est la dictature de la majorité sur la minorité », comment les minorités ethniques sont-elles arrivées à prendre le pouvoir et à le conserver dans un contexte où les clivages ethniques ou tribalistes comme en Lybie ont été créés et entretenus à dessein par les colons puis repris après les indépendances par les clans présidentiels pour assurer la pérennité de leur pouvoir et faire main basse sur les ressources de leur pays ? Les frontières issues de la colonisation n’ayant tenu aucun compte des limites des royaumes, leurs populations se sont retrouvées disloquées entre plusieurs pays.
Une moralisation de la vie politique est souhaitable, ne cesse de rappeler l’auteur. « On ne fait pas de la politique avec la morale, on n’en fait pas davantage sans »[2]. Cela doit passer par l’arrêt de la pratique répandue des achats de consciences et de votes, une libéralisation encadrée des médias, une véritable lutte contre l’impunité et la consolidation de l’État de droit. La démocratie est une idée, les formes démocratiques sont universelles.
Un ouvrage salutaire pour qui se fixe comme objectif de sortir des lieux communs et d’aborder l’Afrique à partir des faits et pas de perceptions fantasmées.
[1] La démocratie. Histoire, théories, pratiques, sous la direction de Jean Vincent Holeindre et Benoît Richard, Éditions Sciences humaines.
[2] L’espoir. André Malraux, Éditions Gallimard Paris 1937