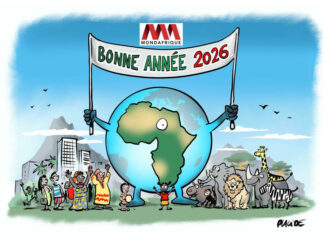L’hypocrisie est le tribut que le vice paie à la vertu. Elle révèle le besoin persistant des responsables politiques de montrer à leurs citoyens et au monde que leur cause, aussi violente soit-elle, aspire encore à la légitimité.
Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique
Michael Walzer a observé un jour, dans Just and Unjust Wars, que « l’hypocrisie est omniprésente dans le discours de guerre, car il est particulièrement important, en de tels moments, de paraître avoir raison. » Son propos n’était pas seulement descriptif mais moral : même en temps de guerre, les dirigeants cherchent à dissimuler leur conduite derrière le langage de la justice. Ils mentent, mais en mentant ils reconnaissent que la justice demeure une norme
Au Moyen-Orient aujourd’hui, cette tradition s’est effondrée. Des snipers abattent des enfants tandis que des experts pédants pontifient sur la proportionnalité et le droit international — discutant pour savoir si les atrocités constituent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide — comme si les mots pouvaient obscurcir le ciblage délibéré des innocents. Les rituels de justification, les gestes vers la loi ou les préoccupations humanitaires ont été abandonnés. Ce que Walzer considérait comme une caractéristique inévitable de la guerre — le tribut rendu à la justice, même sous forme de distorsion — a été rejeté. À sa place se dresse quelque chose de plus sombre : un projet à découvert d’ingénierie démographique, d’accaparement des terres, d’annexion et de fragmentation, poursuivi avec une désinvolture stupéfiante par des dirigeants qui ne ressentent plus le besoin de prétendre être dans leur droit.
Nulle part cela n’est plus évident qu’à Gaza. L’illustration la plus frappante de cette nouvelle posture ne vient pas des opérations militaires mais des tables de négociation diplomatiques. Quand Jared Kushner et son beau-père, le président des États-Unis, pouvaient discuter avec désinvolture, avec des pays comme l’Éthiopie, du déplacement de deux millions de Palestiniens, le masque est tombé entièrement. L’expulsion permanente d’un peuple de sa terre a été traitée comme un élément transactionnel de diplomatie, comme si des êtres humains n’étaient qu’une marchandise excédentaire.
Par le passé, les administrations américaines enveloppaient au moins leur complicité dans la politique israélienne du langage des processus de paix. De Carter à Biden, les présidents invoquaient une solution à deux États, la promotion de la démocratie ou la stabilité régionale. Barack Obama parlait de dignité palestinienne tout en protégeant diplomatiquement Israël. Même les Accords d’Abraham du premier mandat de Trump furent présentés comme des percées pour la « paix ». L’hypocrisie abondait, mais au moins elle reconnaissait la norme. Aujourd’hui, bien loin de l’époque où des responsables comme James Baker, George Shultz ou même Henry Kissinger savaient frapper du poing sur la table pour dire « ça suffit ».
Kushner, lui, s’est passé de toute feinte. Les Palestiniens furent réduits à un problème à « évacuer ». Le déplacement de civils — historiquement l’acte le plus explosif moralement de la guerre — fut requalifié en logistique, vu à travers le prisme d’un projet immobilier. Ce n’était plus de l’hypocrisie. C’était un mépris ouvert de la notion même de justice, un reflet de la conduite morale plus que discutable des États-Unis.
Et Gaza affamée
La famine est devenue le partenaire silencieux des bombardements, une arme méthodique destinée à préparer le terrain au déplacement. Israël a bloqué nourriture, carburant et médicaments, calculant que la faim et la maladie pousseraient les Palestiniens à fuir là où les bombes seules ne suffisaient pas. C’est de l’ingénierie démographique par le siège : briser la volonté d’une population en lui refusant les moyens de survie. Dans le vocabulaire moral de Walzer, l’affamement délibéré de civils est indissociable du massacre, car les deux franchissent la ligne catégorique des crimes de guerre. Et pourtant, cela est aujourd’hui discuté ouvertement, des responsables israéliens admettant que Gaza doit « être réduite en ruines » et que son peuple doit choisir entre la faim et l’exil. La famine, autrefois l’archétype de la tactique injuste, est désormais normalisée comme politique — un exemple de l’indifférence morale de la plupart des gouvernements occidentaux, qui regardent en silence.
Ce qui se dessine n’est pas de l’indifférence mais une intention. Le déplacement n’est pas un accident de guerre ; c’est un objectif. C’est de l’ingénierie démographique — plus exactement du nettoyage ethnique — le remodelage systématique des populations pour assurer un contrôle territorial. À Gaza, le déracinement des Palestiniens sert un double objectif : vider la terre en vue de l’annexion et miner la base démographique de toute future souveraineté palestinienne. Netanyahu a lui-même déclaré que Gaza faisait partie de « la terre d’Israël ». Les générations antérieures de dirigeants israéliens parlaient de « sécurité » et « d’occupation temporaire ». Netanyahu parle de propriété et de permanence — son rendez-vous avec le destin, sa mission talmudique. Gaza, comme la Cisjordanie, doit être absorbée dans le Grand Israël. Le déplacement de son peuple n’est pas un dommage collatéral mais le prélude nécessaire à l’annexion.
Liban, la même logique.
Pendant des décennies, les frappes israéliennes et les politiques américaines furent présentées comme de la contre-terreur ou de la dissuasion. Mais aujourd’hui, le vernis de justification a disparu. Le Liban est traité non comme un État souverain mais comme un terrain jetable où les civils sont des dommages collatéraux et les institutions, accessoires. L’ingénierie démographique y prend la forme d’un déplacement progressif : dépeuplement rural sous les bombardements, fractures sectaires accentuées par les sanctions, et érosion constante de la souveraineté nationale. Le chaos n’est pas accidentel ; il est cultivé. L’intérêt de Netanyahu pour les eaux du Litani illustre combien le déplacement et l’annexion sont intégrés dans la stratégie.
Cela s’inscrit dans une doctrine israélienne plus ancienne de fragmentation et d’annexion. Du plan Yinon des années 1980 au projet Clean Break des années 1990, jusqu’aux stratégies récentes de zones tampons, l’objectif a été constant : affaiblir les voisins en les éclatant en enclaves sectaires. Le Liban a été le laboratoire de cette doctrine, ses guerres civiles et sa politique de milices rendant l’État incapable de résister ou de se consolider. Le résultat : une frontière fragmentée où la souveraineté est impraticable et le déplacement permanent.
« Gérer l’instabilité »
La Syrie et l’Irak suivent le même schéma. En Syrie, l’érosion de l’État fut tolérée — voire facilitée — non pour la démocratie, mais pour l’affaiblissement qu’elle infligeait à l’axe iranien et les opportunités qu’elle ouvrait pour l’appropriation de terres et la fragmentation. Millions de réfugiés, épurations sectaires, chaos milicien : tout fut traité comme un coût acceptable. En Irak, la politique américaine a oscillé entre occupation, ingénierie sectaire et retrait, laissant un État brisé où l’influence iranienne pouvait être accusée mais où la stabilité ne fut jamais restaurée. Les dirigeants appellent cela « gérer l’instabilité », comme si le chaos lui-même était une stratégie.
Walzer écrivait que le génocide et le massacre de civils constituaient les lignes rouges de la guerre — des violations catégoriques qui n’admettent aucune justification. Mais à Gaza et au Liban, de tels actes ne sont pas seulement commis, ils sont évoqués avec désinvolture. Le massacre de civils est décrit comme « tondre la pelouse ». La famine est défendue comme une pression. Le déplacement est traité comme de la logistique. La destruction de quartiers entiers est expliquée comme une nécessité tactique. Nous assistons non seulement à des crimes de guerre, mais à leur normalisation, à une acceptation ouverte de l’indifférence morale.
L’expression la plus claire de cette posture vient de Netanyahu lui-même. Il ne dissimule plus ses ambitions derrière la rhétorique de la sécurité. Gaza est « à nous ». Les colonies de Cisjordanie sont permanentes. Le sud du Liban est évoqué comme une zone tampon, non comme un territoire voisin. Là où d’anciens dirigeants mentaient — parlant de nécessité temporaire, promettant un retrait — Netanyahu proclame la permanence. L’annexion est célébrée. L’ingénierie démographique est assumée. Il ne parle pas de coexistence mais d’effacement.
L’abandon de l’hypocrisie marque un seuil dangereux. L’hypocrisie, aussi creuse soit-elle, témoignait que la justice comptait. Mentir sur le respect des civils, c’était concéder que les civils méritaient le respect. Mentir sur la souveraineté, c’était en reconnaître la valeur. Enrober des bombardements de langage humanitaire, c’était admettre que des principes humanitaires existaient. Le cynisme et l’indifférence morale effacent toute norme. Si les dirigeants ne se sentent plus obligés de paraître avoir raison, ils redéfinissent la légitimité comme un pouvoir brut. Ce n’est pas seulement injuste — c’est insoutenable. Une politique sans hypocrisie est une politique sans contrainte, et une telle politique engendre inévitablement résistance, instabilité et violences renouvelées.
Pour le Liban, pour Gaza, pour la Syrie, la question est de savoir si leurs peuples seront autorisés à exister avec souveraineté et dignité. Pour les États-Unis et Israël, la question est de savoir s’ils choisiront d’abandonner entièrement des prétentions morales qui, peut-être, n’avaient jamais reposé que sur du vent. Comme le suggérait Walzer, l’hypocrisie signalait au moins l’aspiration à la justice. Aujourd’hui, à Gaza et au Liban, nous faisons face à une réalité plus sombre : l’ère de l’hypocrisie est terminée. Les États-Unis et Israël parlent ouvertement de déplacement, de famine, de bombardement, d’annexion et de fragmentation comme politiques. Les civils sont des jetons de négociation, la souveraineté un détail. L’hypocrisie était déjà assez mauvaise, mais sa disparition laisse place à pire : l’absence même de toute prétention à la vertu. Et c’est là le développement le plus dangereux de tous — une chute dans ce que l’on ne peut appeler autrement qu’une hypocrisie juste et injuste.