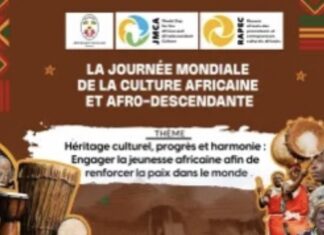Le cœur de la crise libyenne réside dans une profonde division institutionnelle qui paralyse l’État. Depuis l’échec du processus électoral prévu en décembre 2021, la Libye vit sous l’autorité de deux exécutifs rivaux : le gouvernement d’union nationale (GUN), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli sous la direction d’Abdulhamid Dbeibah, et le gouvernement de stabilité nationale (GSN), soutenu par la Chambre des représentants et établi dans l’Est.
Cette dualité du pouvoir exécutif n’a pas seulement entravé toute gouvernance efficace, mais a également renforcé la fracture géographique et politique du pays.
Au niveau législatif, la Chambre des représentants et le Conseil d’État, dirigés respectivement par Aguila Saleh et Khaled El-Meshri, n’ont pas réussi à s’accorder sur une base constitutionnelle pour organiser des élections, malgré plusieurs rounds de dialogue à Genève, au Caire et ailleurs. Cet échec n’est pas qu’un simple différend technique : il reflète une lutte plus profonde pour le pouvoir, où ces institutions sont désormais perçues comme faisant partie du problème plutôt que de la solution. Leurs dirigeants semblent prolonger délibérément la transition pour préserver leur influence et leurs intérêts. Cette « impasse politique » a érodé la légitimité de toutes les instances en place et menace directement l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye.
Un paysage sécuritaire fracturé : une poudrière à Tripoli et au-delà
La paralysie politique s’accompagne d’une situation sécuritaire extrêmement fragile et complexe. La capitale, Tripoli, vit dans une tension permanente et a récemment connu une escalade inquiétante avec l’assassinat d’Abdel ghani Al-Kikli (dit « Ghniwa »), chef de l’Appareil de soutien à la stabilité. Cet événement a révélé la profondeur des rivalités entre milices se disputant le contrôle de la capitale.
Le paysage sécuritaire reste dominé par des groupes armés opérant en dehors de l’autorité de l’État, chacun avec ses propres allégeances politiques et sources de financement. L’objectif affiché lors des conférences de Berlin – démilitariser ces groupes et les intégrer dans une structure sécuritaire unifiée sous commandement civil – reste largement inachevé.
La situation est encore compliquée par la présence persistante de forces étrangères et de mercenaires sur le sol libyen, notamment :
- Les troupes turques soutenant le gouvernement de Tripoli
- Les mercenaires russes appuyant le Commandement oriental
- Des combattants venus du Soudan et du Tchad
Cette présence étrangère viole non seulement les résolutions de l’ONU et les engagements de Berlin, mais attise aussi le conflit, sape la souveraineté libyenne et rend toute solution sécuritaire intérieure tributaire des rivalités régionales et internationales.
Pressions socio-économiques et colère populaire
La crise politique a entraîné une détérioration brutale des conditions économiques et sociales, alimentant un mécontentement généralisé. Des mouvements de protestation ont émergé dans plusieurs villes, notamment en Tripolitaine :
- À Tripoli, les mouvements de « Souk El Joumoua « [2] et « Volonté du peuple » ont appelé à des manifestations massives pour exiger le départ des institutions actuelles et la formation d’un nouveau gouvernement menant à des élections.
- À Misrata (ville natale de Dbeibah), le « Mouvement de la jeunesse de Misrata »a dénoncé les pratiques « répressives » du pouvoir.
Ces mobilisations reflètent une volonté croissante des Libyens de rejeter une classe politique qu’ils jugent responsable de leurs souffrances. Cependant, ces mouvements font face à des tentatives de récupération par des acteurs rivaux. Par exemple, le mufti Al-Sadoc Al-Ghiriani a appelé à des contre-manifestations, qualifiant la conférence de Berlin de « complot étranger ».[3]
La bataille du pouvoir
Pour comprendre l’échec successif des initiatives visant à résoudre la crise libyenne, il faut dépasser le récit superficiel qui accuse uniquement « l’absence de volonté politique ». La raison profonde réside dans trois enjeux fondamentaux et organiquement liés, formant ce qu’on pourrait appeler la « trilemme » : la résolution de chaque problème étant conditionnée par le règlement simultané des deux autres. Ces enjeux sont :
- Le défi de l’unification des institutions militaires
- La lutte pour les ressources économiques
- L’impasse constitutionnelle : Un paravent juridique
Les désaccords affichés portent sur la « base constitutionnelle« devant encadrer les élections. Bien que le débat semble technique et juridique, il s’agit en réalité d’un conflit politique pur : qui aura le droit de gouverner la Libye demain ?
Ces divisions ont paralysé les travaux de la commission « 6+6 » (composée de membres des deux chambres rivales : la Chambre des représentants et le Conseil d’État) et ont directement contribué à l’échec des élections de décembre 2021.
Principaux points de discorde :
|
Point de conflit |
Position de l’Est |
Position de l’Ouest |
|
Nature du régime |
Présidentialiste fort |
Système parlementaire équilibré |
|
Critères d’éligibilité |
Exclusion des civils sans expérience |
Ouverture à des candidats indépendants |
|
Rôle de l’armée |
Contrôle militaire accru |
Subordination stricte au pouvoir civil |
Cette bataille masque une réalité plus crue: les institutions actuelles instrumentalisent le processus constitutionnel pour préserver leurs privilèges. Le Conseil d’État (proche de Tripoli) craint une marginalisation dans un système présidentiel, tandis que la Chambre des représentants (à l’Est) y voit un moyen de consolider l’influence de son camp.
Les points de divergence constitutionnels : une analyse comparative
|
Point litigieux |
Position de la Chambre des Représentants (Est) |
Position du Conseil d’État (Ouest) |
Enjeu stratégique |
|
Éligibilité des militaires |
Permettre aux militaires de se présenter à la présidentielle avec une démission temporaire de leurs fonctions |
Exiger une démission permanente bien avant les élections |
Influence directement la possible candidature du maréchal Khalifa Haftar |
|
Éligibilité des binationaux |
Opposition marquée visant à exclure les candidats détenteurs d’une double nationalité |
Position plus flexible (certains alliés étant eux-mêmes binationaux) |
Outil d’exclusion de figures politiques spécifiques |
|
Séquence électorale |
Privilégie des présidentielles en premier pour établir un exécutif fort |
Favorise des législatives d’abord pour créer un pouvoir parlementaire de contrôle |
Détermine l’architecture étatique future et l’équilibre des pouvoirs |
|
Sortie du projet constitutionnel de 2017 |
Ignoré au profit d’une nouvelle base constitutionnelle |
Certaines factions proposent de soumettre le texte existant à référendum |
Choix entre capitaliser sur un travail existant ou repartir de zéro (prolongeant la transition) |
Le défi de l’unification des institutions militaires : Qui contrôle les armes ?
La Commission militaire 5+5, composée de cinq officiers supérieurs de l’Est et cinq de l’Ouest, constitue le principal mécanisme de dialogue sécuritaire. Bien qu’elle ait réussi à conclure un accord de cessez-le-feu en 2020, elle n’a guère progressé dans sa mission fondamentale : unifier les forces armées sous un commandement unique.[6]
Ce défi est colossal. Il ne s’agit pas seulement d’intégrer deux armées rivales, mais aussi des dizaines de milices et groupes armés aux allégeances et idéologies divergentes dans une structure militaire professionnelle soumise à l’autorité civile. La « Commandement général » dirigée par le maréchal Khalifa Haftar continue d’agir comme une armée parallèle dans l’Est, tandis que les factions de l’Ouest tentent de former une « force militaire commune », entravées par un profond déficit de confiance. Chaque camp considère ses forces armées comme le dernier rempart de sa survie politique, transformant toute démarche de désarmement ou d’intégration en une périlleuse prise de risque.
La bataille pour les ressources économiques : Les butins de l’État
La lutte pour le contrôle des institutions économiques souveraines – notamment la Banque centrale de Libye et la Compagnie nationale de pétrole (NOC)[7] – alimente durablement le conflit. Qui maîtrise les revenus pétroliers détient le pouvoir de payer les salaires, financer ses troupes, acheter des allégeances et consolider son emprise.
La Libye ne dispose pas de budget unifié. Le gouvernement de l’Est accuse la Banque centrale à Tripoli de distribuer inéquitablement la richesse, tandis que l’Ouest reproche à l’Est d’utiliser le pétrole comme arme politique via des fermetures répétées de champs pétrolifères. Même les récents efforts de la NOC pour lancer de nouveaux appels d’offres aux investisseurs étrangers se heurtent à cette fracture politique.
Une trilemme interdépendante
Ces trois enjeux ne sont pas des défis distincts solubles par des approches parallèles, comme Berlin l’a vainement tenté. Ils forment une « trilemme » inextricable :
- Aucun camp n’acceptera une loi électorale (volet politique) pouvant conduire à sa défaite sans garanties contre un usage hostile des ressources militaires et économiques par le vainqueur.
- Aucun chef militaire n’intégrera ses forces (volet sécuritaire) sans règlement politique préservant ses intérêts.
- Aucune faction ne lâchera son contrôle sur les revenus pétroliers (volet économique) sans accords politiques et sécuritaires anti-marginalisation.
Ce cercle vicieux a scellé l’échec de Berlin 1 et 2. Toute tentative à Berlin 3 de pousser un seul volet (comme les élections) sans règlement simultané des deux autres ignore la structure des incitations libyennes et est vouée à l’échec.
Dans notre prochain article, « La troisième conférence de Berlin, l’ultime tentative avant l’effondrement. »
[4] https://www.auswaertiges-amt.de/fr/newsroom/2294236-2294236
[5] https://french.ahram.org.eg/News/38867.aspx
[6] https://dppa.un.org/en/libyan-55-joint-military-commission-to-meet-libya-first-time