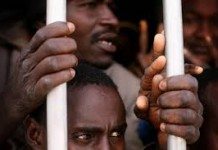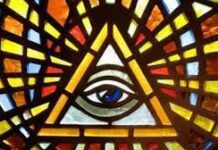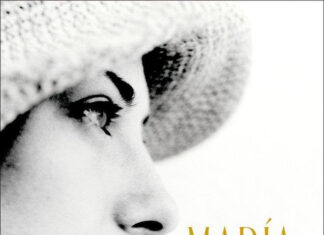Si l’Arabie saoudite incarne le modèle d’un despotisme modernisateur fondé sur l’argent et l’image, la Turquie et l’Égypte illustrent quant à elles une forme d’autoritarisme plus classique, enraciné dans la mythologie nationale et la verticalité militaire.
Mais derrière des façades opposées — islam politique d’un côté, laïcisme militaire de l’autre — ces deux États partagent des logiques de pouvoir similaires : personnalisation extrême, répression des contre-pouvoirs, instrumentalisation de la religion, et effondrement du débat public.
En Turquie, Recep Tayyip Erdogan règne depuis plus de deux décennies sur un pays profondément transformé. De leader islamo-conservateur élu à figure néo-sultanique, son évolution a suivi une pente autoritaire constante. Révisions constitutionnelles successives, purge massive de la fonction publique après le putsch avorté de 2016, mainmise sur les médias et la justice : le président turc a bâti un régime hyperprésidentialisé où toute dissidence est assimilée à une trahison. Son palais à Ankara, symbole d’un pouvoir monarchisé, traduit cette volonté de mise en scène permanente de l’autorité.
Le paradoxe turc tient dans la capacité d’Erdogan à conjuguer autoritarisme interne et ambition géopolitique. Il se rêve en arbitre des conflits du monde musulman, intervenant en Syrie, en Libye, dans le Caucase, tout en menant une politique active dans les Balkans et en Afrique. Cette hyperactivité diplomatique, nourrie d’un néo-ottomanisme assumé, masque toutefois une réalité intérieure préoccupante : inflation galopante, dévaluation de la livre turque, polarisation politique extrême, exode des élites.
L’Égypte, un autoritarisme implacable
En Égypte, Abdel Fattah al-Sissi incarne un autre visage du pouvoir autoritaire : celui du maréchal-président, issu de l’armée, arrivé au pouvoir par la force après l’éviction de Mohamed Morsi. Depuis 2013, l’Égypte vit sous un régime sécuritaire implacable : des dizaines de milliers de prisonniers politiques, une répression systématique des ONG, des médias sous contrôle total. Le discours du régime repose sur un double récit : sauver l’État de la menace islamiste, et restaurer la grandeur perdue de l’Égypte antique et nassérienne.
Mais derrière les slogans, le pays s’enfonce dans une crise économique grave. Les projets pharaoniques – comme la nouvelle capitale administrative dans le désert ou la mosquée géante de l’armée – sont financés par une dette croissante, tandis que l’inflation appauvrit les classes moyennes et que le FMI impose des mesures d’austérité. La population, privée d’espace de contestation, subit une double peine : l’absence de libertés et un appauvrissement structurel.
Dans ces deux pays, les élections sont devenues des rituels sans enjeu. Le Parlement est une chambre d’enregistrement, les partis d’opposition sont soit interdits, soit cooptés, soit neutralisés. L’État se confond avec le chef, et la nation avec sa survie politique. Cette confusion entre légitimité et pouvoir personnel empêche toute forme de régénération politique. L’avenir y est à la fois bouché et sous surveillance.
La Turquie et l’Égypte, autrefois moteurs du monde sunnite, sont devenues des puissances à la dérive, qui inspirent plus de crainte que d’adhésion. Elles illustrent l’impasse de l’autoritarisme néo-national, incapable de répondre aux aspirations d’émancipation, de justice sociale et de représentation politique qui animent encore les jeunesses arabes et musulmanes. Leur paralysie institutionnelle est à l’image du système qu’elles incarnent : centralisé, rigide, épuisé.