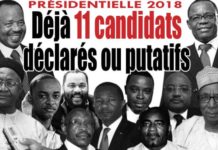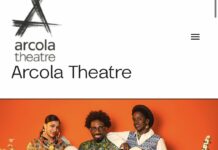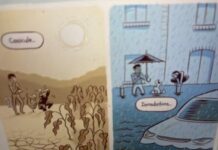Quatorze ans après le soulèvement de 2011, la Syrie ne s’est pas relevée : elle s’est transformée. À la figure glacée du despotisme baassiste incarnée par Bachar al-Assad succède aujourd’hui une autorité plus trouble, plus ambiguë, mais tout aussi problématique.
Le pouvoir post-dictatorial est sans cap, sans souffle et surtout infiniment fragile. Ahmad Al Charaa, un ancien cadre islamiste passé par les marges du djihadisme, l’incarne dans le langage policé des conférences internationales, mais sans la capacité d’apaiser les tensions dans un pays fragmenté plus que jamais.. Cette transition de façade ne trompe personne. Le système de violence et de luttes territoriales reste intact, les lignes de fracture plus vives que jamais, et le processus de réconciliation, inexistant.
La Syrie actuelle est une mosaïque d’illusions contradictoires. Un État nominalement unifié mais en réalité éclaté entre zones d’influence russe, turque, iranienne et kurde ; gouvernement central affaibli mais toujours répressif ; population exsangue, fragmentée, méfiante. Dans ce décor post-apocalyptique, les apparences de normalité sont des simulacres. Des ministres pour signer des protocoles, des ambassadeurs pour occuper des sièges vides, et des discours de reconstruction démentis par les ruines omniprésentes.
Le pouvoir de Charaa cherche aujourd’hui à obtenir la levée des sanctions occidentales et à relancer l’aide internationale. Pour cela, il tente de se présenter comme une figure de stabilisation. Mais cette stratégie repose sur une hypocrisie fondamentale qui fait l’impasse sur la justice transitionnelle, nie la mémoire des massacres commis par le régime précédent, et refuse toute inclusion réelle des minorités, en particulier alaouite et druze, désormais perçues comme suspects potentiels.
La gestion de la question druze
L’épisode récent des violences visant la communauté druze dans les universités d’Alep et de Homs est emblématique de cette dérive. À l’origine, un enregistrement truqué attribué à un cheikh druze insultant le Prophète. Résultat : appels au massacre, lynchages, et silence radio des autorités. Ce silence est plus qu’un aveu : c’est une stratégie. Laisser monter la haine confessionnelle pour canaliser la peur, contrôler la rue, et réinstaurer l’ordre par le chaos. Le pouvoir joue ici une carte dangereuse, celle du « laissez-faire confessionnel », où chaque communauté devient à la fois bouc émissaire et ligne rouge.
Dans ce contexte, l’intervention israélienne se veut protectrice des Druzes — mais elle aggrave encore la perception d’une collusion, renforçant l’idée d’un “Druze agent d’Israël”, et donc traître. Le piège se referme. Ceux qui se sentent menacés par le régime le sont aussi par ses ennemis. La politique de la peur remplace toute architecture de paix.
Autre signe de fragmentation inquiétante : l’annonce par Rami Makhlouf, cousin de l’ex-président, de la création d’une milice exclusivement alaouite. Ce geste, loin d’être marginal, révèle la nature du système en place : incapable de créer des institutions transversales, il se replie sur des logiques communautaires armées. La Syrie devient ainsi un archipel de milices, où chaque région, chaque clan, chaque confession tente d’assurer sa survie à défaut d’un avenir.
Le déni du pouvoir syrien
Or le pouvoir politique refuse de nommer les tensions, encore moins de les apaiser. Le récent appel du mufti à l’apaisement — tardif, formel, isolé — n’a pas empêché les affrontements de se poursuivre dans la région de Sweida. La Syrie n’est plus un État failli : c’est un État fragmenté, où l’État lui-même est un acteur parmi d’autres, sans capacité de régulation ni horizon de légitimité.
L’internationalisation du conflit, déjà ancienne, prend aujourd’hui de nouvelles formes. La Turquie continue d’imposer ses intérêts dans le nord syrien, en y administrant des zones entières. Israël multiplie les frappes ciblées sur des positions iraniennes ou pro-iraniennes. La Russie maintient sa présence militaire, mais sans engagement politique réel. Quant aux puissances arabes, elles oscillent entre normalisation opportuniste et indifférence stratégique. Personne ne croit plus à une solution politique : chacun gère son périmètre.
Le régime, quant à lui, ne propose rien. Il ne réforme pas, ne dialogue pas, ne reconstruit pas. Il gère l’effondrement comme une routine, comme si la survie suffisait à justifier son existence. Il laisse les exils se multiplier, les minorités s’alarmer, les confessions s’armer. Et dans cet apparent calme administratif, se rejoue la tragédie d’un pays réduit à sa peur.